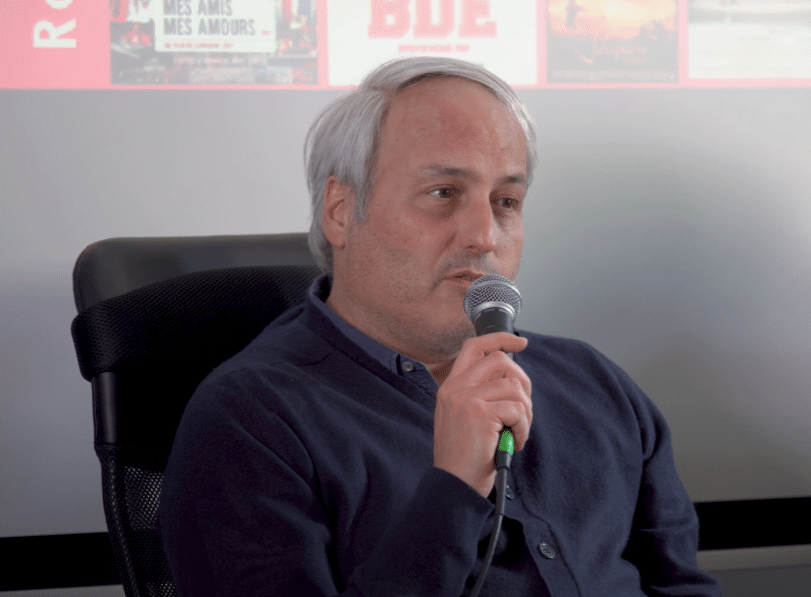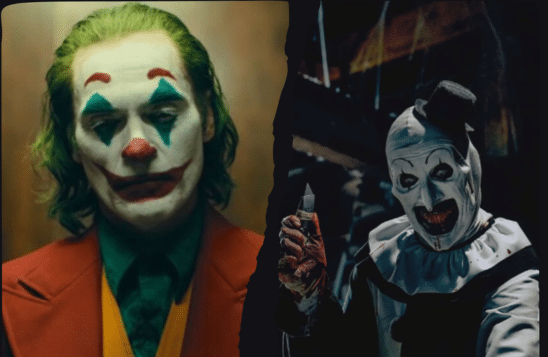L’Institut National de l’Audiovisuel, abrégé en INA, est un établissement public à caractère industriel et commercial. L’INA assure plusieurs missions ; conservation du patrimoine audiovisuel français, missions de recherche et création audiovisuelle. Il endosse un rôle de formateur auprès des professionnels ou des étudiants en audiovisuel. Zoom sur les missions, les rôles et l’importance de l’INA pour l’industrie audiovisuelle française.

L’INA : qu’est-ce que c’est ?
L’INA est créé en 1974, suite à une loi portant la création d’un EPIC dont le rôle est de conserver des archives, d’assurer des missions de création et de formation audiovisuelle. Cette réforme de l’audiovisuel, dont la mise en place a pleinement lieu en 1975, donne à l’INA des rôles qui sont fixés par l’État. C’est donc le gouvernement qui contrôle ses activités (des membres du gouvernement et des parlementaires font partie de son conseil d’administration). L’État dispose également d’un droit d’enquête et de rapport, l’INA recevant une partie de la redevance audiovisuelle pour financer ses activités.
Depuis cette date, l’INA n’a pas changé de statut. Elle voit toutefois son champ d’action s’élargir en 1992 et au tournant des années 2000. L’INA conserve depuis lors des formats numériques, des extraits d’émission TV, Radio ou même des contenus web. En 2002, le dépôt légal de l’EPIC est étendu aux chaînes du câble, du satellite et depuis 2005 aux chaînes numériques de la TNT.
La numérisation de son fond de collection dans les années 2000 a été considérée comme un projet d’importance prioritaire et a donné lieu à des opérations massives et systématiques. Il a permis de sauvegarder des archives menacées de dégradation et a sauvé quelque 600 000 heures de la destruction inéluctable.
En 1998, son ouverture au public est effective (au rez-de-jardin de la bibliothèque François Mitterrand). En outre dès 2006, l’INA offre l’accès à ses collections numérisées à tous les citoyens, gratuitement et à toute heure depuis son site ina.fr. En ligne sont accessibles près de 1000 000 œuvres, soit 10 000 heures de programmes. 80 % de ces contenus sont gratuits.
Le rôle de conservation du patrimoine audiovisuel français de l’INA
Il s’agit de la première mission de l’INA, qui se doit de conserver le patrimoine audiovisuel. Pour y parvenir, elle assure des missions de collecte, de sauvegarde et de restauration des œuvres. Ses collections sont composées de toute la variété des supports de l’audiovisuel et proviennent de nombreuses sources :
- Des archives professionnelles, composées des extraites des chaînes publiques et TV et de radio depuis 1945.
- Les diffusions des chaînes hertziennes de radio et de TV depuis 1995.
- Le dépôt des sites web médias, web radios et web TV (depuis 2006).
- Des fonds issus de collections privées : Opéra de Paris, Fédération française de football, etc.
Son rôle de protectrice des œuvres audiovisuelles passe, notamment, par la numérisation de son fond de collection. Quant à la restauration, elle est désormais envisagée également via les logiciels.
INA : la mise en valeur et la diffusion des fonds de collections
L’INA assure donc un rôle de diffuseur des œuvres à sa charge. L’institut propose des services spécifiques à destination des professionnels en France et à l’étranger.
L’INA assure une mission de transmission du patrimoine audiovisuel en travaillant auprès du grand public au moyen d’une politique éducative et culturelle. Elle intervient en proposant ses supports filmés à l’occasion de festivals, d’expositions ou de rétrospectives. Via ses services en ligne (site internet, application, TV connectées, etc), elle assure la promotion de son fond en offrant l’accès à plus de 45 000 heures de programme.
Elle met en avant ses collections de manière ludique, en organisant des dossiers thématiques de ses archives, en lien avec l’actualité (passage d’une personnalité en plateau TV, anniversaire, etc).
Les moyens dont use l’INA pour mettre en valeur ses collections dépendent du médium de l’œuvre. Ses fonds sont d’ailleurs caractérisés par la grande variété des formats : cinéma, télévision, radio, publicité, photographies, fonds régionaux, sites internet, infographies, etc.

L’INA et son rôle de chercheur
La mission de recherche et d’expérimentation sur l’image et le son fait de l’INA un haut lieu de recherche et de formation. 95 % de ses activités dans ce secteur sont désormais dédiées à la conservation des œuvres.
Elle poursuit également un objectif de développement des pratiques et des méthodologies dans l’audiovisuel. Elle s’associe à des universités au même titre que des entreprises privées et développe des solutions de classement des contenus multimédias, de traçage des images, etc.
L’INA assure aussi un rôle de producteur dans le paysage audiovisuel français. Elle intervient dans la création musicale, propose des documentaires audiovisuels ou même des contenus pédagogiques.
Car, l’INA, c’est aussi un centre de formation aux métiers de l’audiovisuel. L’INA Sup assure un rôle de formateur auprès de 250 élèves en formation post-bac. L’institut délivre des diplômes de licence ou des mastères spécialisés. Elle assure également un rôle auprès des professionnels en les accompagnant dans le développement de leurs compétences. Elle intervient par le biais de formations et de séminaires professionnels dans de nombreux secteurs d’activité : gestion de production, journalisme, management des contenus, etc.
Comment l’INA assure ses rôles après la fin de la redevance audiovisuelle ?
Les contenus que propose l’INA sur son site sont à 80 % gratuits, l’internaute peut visionner les premières minutes des œuvres payantes. Afin de financer ses missions, l’INA propose le téléchargement payant de certains éléments de son fond de collection. Il existe plusieurs formules : location ou achat des programmes.
L’EPIC a aussi signé des accords avec les géants Dailymotion et Youtube. Les plateformes peuvent diffuser une partie de ses vidéos contre le partage des revenus publicitaires.
Son service INA MEDIAPRO recherche, sélectionne et commercialise les droits d’exploitation des œuvres audiovisuelles. Les professionnels désireux d’utiliser un support audiovisuel à des fins promotionnelles financent ainsi indirectement les activités de l’EPIC.
Les étudiants de l’ISA qui préparent le BTS Métiers de l’Audiovisuel apprennent tout des institutions du cinéma en France. Ils comprennent le rôle de l’INA et sont sensibilisés à son importance dans le cadre d’un apprentissage de haut niveau, structuré autour de stages pratiques.
À l’étranger, l’INA assure un rôle contribuant au rayonnement de la France : conseil aux institutions et aux entreprises, aide aux pays en guerre afin de reconstituer leur mémoire audiovisuelle, etc.